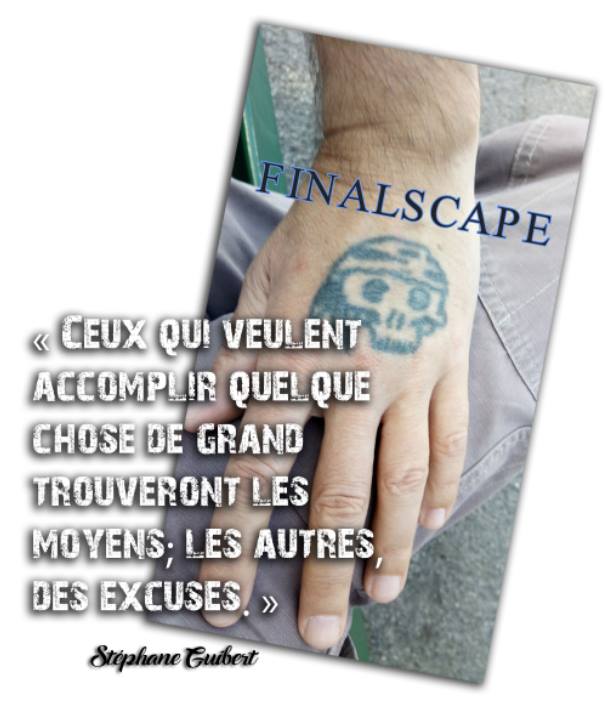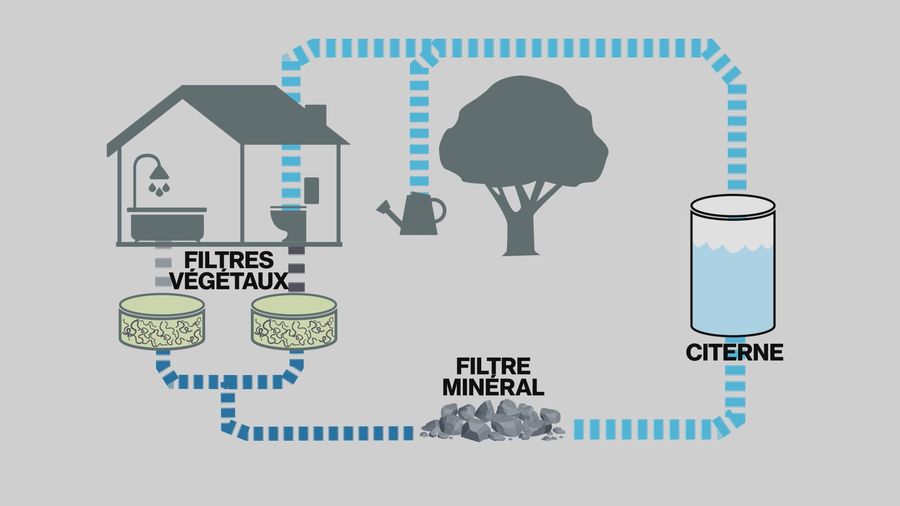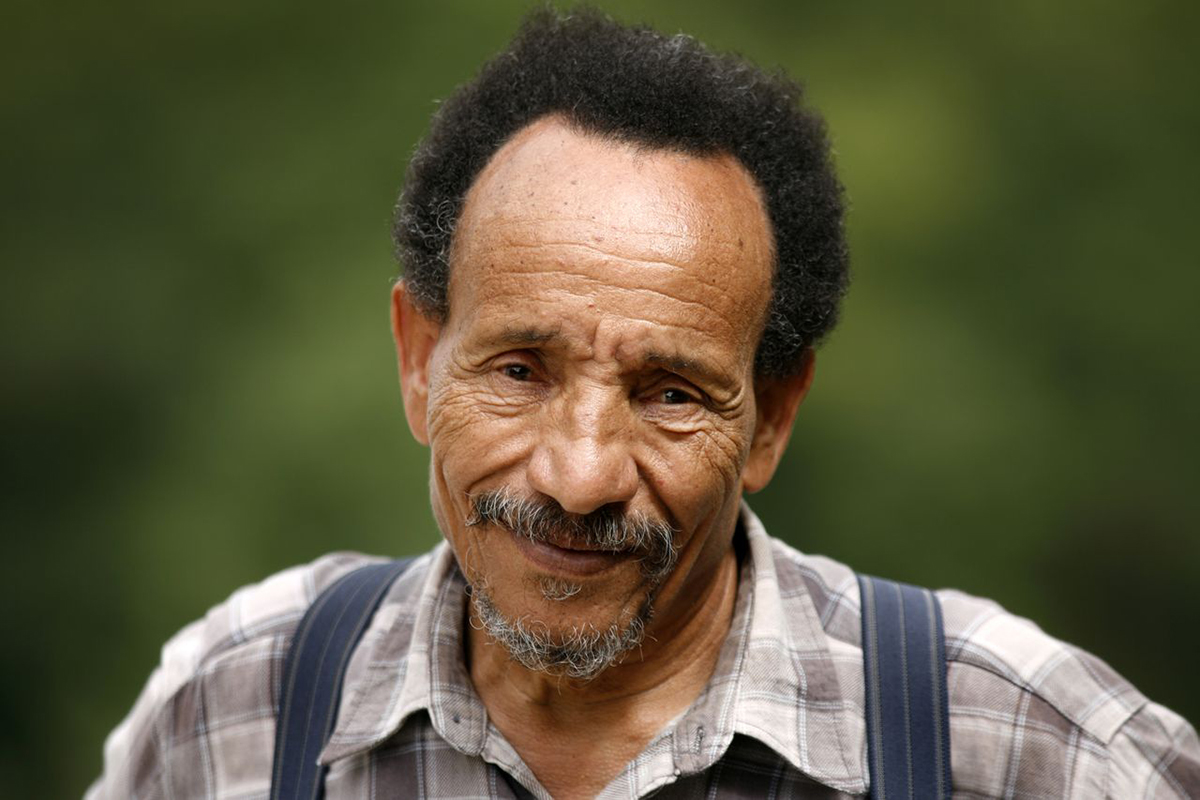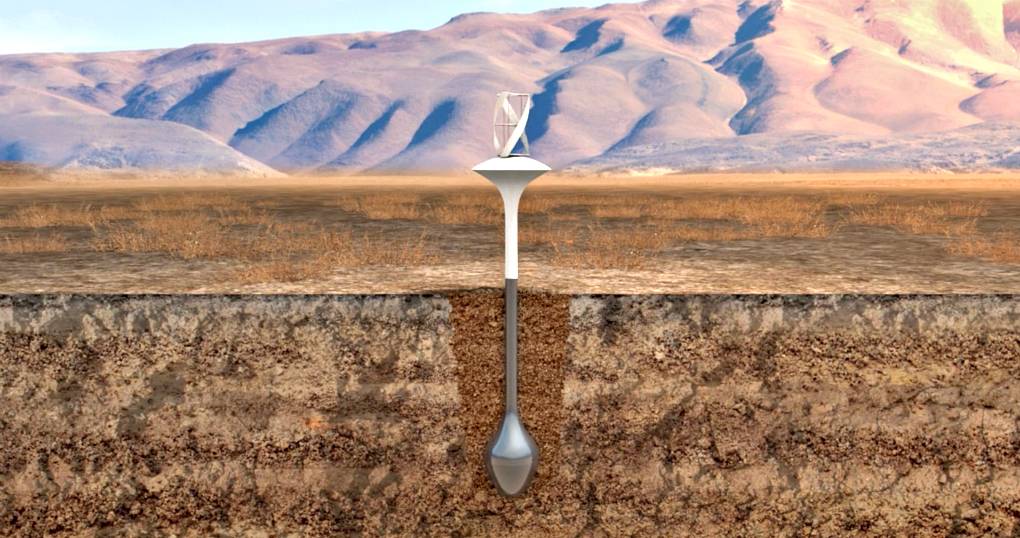La « guerre du sable » est déclarée.
Sous l’effet du boom de la construction, les besoins en sable sont de plus en plus énormes. Le pillage du sable marin menace les côtes et les plages de nombreux pays. Et la France n’est pas épargnée !
Y aura-t-il bientôt des navires aspirateurs de sable au large de Lannion, dans le Nord de la Bretagne ? Le Peuple des dunes, un collectif qui lutte contre ce projet d’extraction depuis près de cinq ans et réunit pêcheurs, plaisanciers, professionnels du tourisme, élus et associations écologistes, espère bien que non. La menace, pourtant, se précise. En septembre 2015, le Premier ministre Manuel Valls et le ministre de l’Économie Emmanuel Macron ont accordé la « concession de la Pointe d’Armor » à la Compagnie armoricaine de navigation (CAN), société extractrice membre du groupe international Roullier. Deux mois plus tard, le préfet signait les arrêtés autorisant le début des travaux [1]. La contestation de l’accord de concession devant le Conseil d’État pourrait retarder le lancement de l’extraction. Mais,« à compter de 2016, le pompage du sable risque de commencer à tout moment », craint Odile Guérin, géologue et élue de Trébeurden, l’une des treize communes concernées par le projet.
Pour extraire du sable de mer d’une « dune sous-marine », un bateau avançant à faible vitesse (entre 2 et 4 km/h) traîne une élinde – sorte de tuyau d’aspirateur géant. Le sable aspiré est recraché sur le pont. Une partie de l’eau est aussitôt rejetée à la mer. Au fond de l’eau, là où passe l’élinde, se forme un nuage de sable que l’on qualifie de « turbide ». C’est la première source d’inquiétude des opposants au projet de la CAN. « La turbidité assombrit l’eau, indique Odile Guérin. Le sable soulevé par l’élinde va aller se déposer bien au-delà de la zone d’extraction, ce qui risque de tuer la végétation. » Autre souci : la dune est une zone de reproduction et de refuge pour les lançons, de tout petits poissons qui forment le début de la chaîne alimentaire. « C’est un vrai problème pour les pêcheurs. Sans parler de tous les petits organismes qui seront déchiquetés par l’élinde avant d’être remis à l’eau. »
Des besoins pour l’agriculture intensive
Située à moins de dix kilomètres de la côte, à une quarantaine de mètres de profondeur, la dune sous-marine sur laquelle lorgne la CAN est composée d’une accumulation de débris de coquilles, que l’on appelle « sable coquillier ». On l’utilise dans l’agriculture pour désacidifier les terres. « Avant, pour amender les sols trop acides, on se servait d’une algue : le maërl, rapporte Patrice Desclaud membre du collectif Peuple des dunes. Mais c’est désormais une espèce protégée, on se tourne donc vers le sable. Ce besoin est lié à l’agriculture intensive : les amendements azotés – et notamment les déjections animales – acidifient beaucoup les sols [2]. » La CAN exploite déjà trois autres gisements au large de la Bretagne, avec un volume extrait de 208 000 mètres cubes par an au total. Au large de Lannion, l’entreprise envisageait de pomper jusqu’à 400 000 mètres cubes par an.

Les besoins agricoles ne justifient pas à eux seuls les aspirations de sable au large des côtes. Fabrication du verre, élaboration de cosmétiques et de détergents, rechargement des plages, fracturation hydraulique : le sable sert à une multitude d’activités. Il contient en plus divers minéraux stratégiques tels que le silicium, le titane ou le thorium, à la base de nombreux micro-processeurs. Le sable sert aussi au secteur des bâtiments et travaux publics : fondations, pavement et revêtement des routes, voies ferrées, digues, bétons.
20 kilos de granulats par Français et par jour
Chaque année, la France consomme 450 millions de tonnes de granulats – sable et graviers – pour satisfaire ses besoins de construction. Cela représente sept tonnes par an pour chaque habitant, soit 20 kilos par jour ! Plus ou moins concassés selon leur usage, ces granulats sont principalement issus des carrières terrestres : 200 millions de tonnes en sortent chaque année. Seconde origine : les berges et anciens lits de rivières d’où l’on tire plus de 100 millions de tonnes de sable alluvionnaire chaque année. Viennent ensuite le recyclage (déchets issus du secteur de la déconstruction notamment), puis la mer, qui fournit actuellement 7 millions de tonnes de granulats par an [3].
« La part de granulats marins reste marginale en France », commente Eric Chaumillon, professeur en géologie marine à l’université de La Rochelle et chercheur au CNRS. Elle est bien moindre que chez les champions européens de cette discipline : la Grande-Bretagne (20 millions de tonnes) et la zone Belgique-Pays-Bas (45 millions de tonnes). Dans ces régions, « les ressources à terre sont limitées ou épuisées, il existe une pression environnementale forte sur les carrières et une forte consommation », remarque Eric Chaumillon. La France, quadrillée par de nombreuses carrières, n’est pas dans la même situation. Mais l’épuisement des ressources terrestres et l’opposition croissante des riverains compliquent leurs ouvertures et agrandissements.
Les grands bétonneurs investissent la mer
Face à ces difficultés, les ressources marines sont-elles une solution ? « Les granulats marins, c’est à peine 2 % de la production nationale, remarque Mathieu Hiblot, de l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG), et c’est une production qui n’a pas tendance à se développer. » Du côté de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer), le son de cloche est un peu différent : « Cette réserve est de plus en plus sollicitée. Déjà, des demandes de permis de recherche de grande ampleur, sur des surfaces de 400 kilomètres carrés environ, sont déposées, laissant augurer une augmentation de la production de matériaux d’origine marine », mentionne un article de deux chercheuses de l’institut, paru en octobre 2013. Dans la Manche, six nouveaux titres miniers ont été accordés entre 2011 et 2013, avec des autorisations d’extraction qui courent jusqu’en 2043.

Parmi les groupements d’intérêt économique qui ont obtenu ces titres miniers, on retrouve de grands bétonneurs français comme Vinci ou Lafarge, ainsi que l’italien Italcementi ou le mexicain Cemex. Sur la façade atlantique, interviennent GSM, filiale du groupe Italcementi, ou encore Colas, filiale de Bouygues, en charge de la construction de routes et de la fabrication du béton. « Pour les régions situées à proximité de la côte, les gisements de granulats marins sont indispensables, concède un fonctionnaire du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. La Bretagne, la Loire-Atlantique, le Poitou-Charentes, déficitaires en granulats terrestres, sont des territoires attractifs, où la demande en béton est supérieure à la moyenne nationale (exceptée l’Île-de- France). »
Des études d’impact bâclées ?
Quels sont les risques pour les milieux marins ? L’UNPG assure que, « au bout de trois à cinq ans environ, la situation est à peu près revenue à l’état initial. Dans certains lieux, on a constaté un enrichissement de la biodiversité après dragage, l’évolution du milieu naturel ayant été propice à de nouvelles espèces. » L’Ifremer est un peu moins enthousiaste : « L’exploitation du fond de la mer, quels que soient son objectif et les précautions prises, entraîne des modifications temporaires ou permanentes du milieu marin. Ce système est complexe, et l’interdépendance des compartiments liquide, solide et vivant est telle que la modification de l’un d’eux peut entraîner une évolution irréversible du milieu. »

L’étude d’impact que les entreprises doivent fournir quand elles déposent leur demande d’extraction est censée évaluer les risques pour le milieu et pour les activités économiques qui en dépendent. « Chez nous, elle a été bâclée, estime Odile Guérin. Elle a été faite trop rapidement et aucun état initial n’a été réalisé, alors qu’il est normalement obligatoire. » Qu’en pense la CAN ? Elle n’a pas répondu à nos questions. « L’entreprise n’a pas été transparente du tout, à aucun moment, ajoute Odile Guérin. Même les élus ont été prévenus du projet par voie de presse ! » Les citoyens de la baie de Lannion regrettent aussi de n’avoir pas été mieux entendus au cours de l’enquête publique. « La population a massivement participé à l’enquête publique, et plus de 99 % des avis étaient négatifs. Les treize communes concernées ont toutes dit qu’elles ne voulaient pas du projet. La communauté d’agglo a aussi dit non. Résultat ? Le commissaire enquêteur donne un avis favorable. À quoi ça sert de consulter la population si on ne tient pas compte de ce qu’elle demande ? »
Menaces pour les plages ?
Y a-t-il, au large de Lannion ou ailleurs en France, une menace de disparition des plages, comme le craignent certains riverains, élus ou professionnels du tourisme ? « Il y a beaucoup d’incertitude sur ce point, chaque côte et avant-côte ayant ses propres caractéristiques, souligne Eric Chaumillon. Une analyse spécifique doit être conduite sur chaque site d’extraction potentiel, en prenant en compte la profondeur d’eau, la distance à la côte, la distribution des bancs de sable, l’exposition de la côte, le climat des vagues, les courants de marée et le marnage, la direction et l’amplitude des tempêtes, la réfraction et la réflexion des vagues, la nature sédimentaire des fonds marins. » Les études d’impact qui accompagnent les demandes d’autorisation d’extraction tiennent-elles compte de ces différents paramètres ? Pas toujours, si l’on en croit les conclusions de l’enquête publique menée dans l’estuaire de la Gironde, où le groupe Italcementi aimerait aspirer quelque 400 000 mètres cubes de sable chaque année.
Dans les scénarios étudiés par l’étude d’impact, le coefficient de marée le plus important pris en compte est 95, loin des situations critiques que connait fréquemment la région, avec des coefficients supérieurs à 100. Idem pour la houle, qui a été sous-estimée. « Le problème, selon Eric Chaumillon, c’est le cumul de pressions, avec des régions dans lesquelles on a construit trop près des côtes, et où il y a des tempêtes de plus en plus régulières. Extraire du sable dans ces endroits n’est pas forcément bienvenu même si les quantités prélevées sont faibles au regard des stocks disponibles. »

Ailleurs dans le monde, les prélèvements de sable marin sont tels que des îles disparaissent, et que les plages sont avalées par les flots. Sorti en 2013, le documentaire de Denis Delestrac Le sable, enquête sur une disparition dresse un panorama de ces problèmes que l’auteur attribue en grande partie aux ponctions sauvages effectuées pour approvisionner le secteur du BTP, notamment en Asie et dans la péninsule Arabique [4]. Les entreprises françaises qui interviennent dans ces parties du monde parviennent-elles à échapper à ce trafic ? D ’où vient le sable des usines des centrales à béton que Lafarge détient en Chine ? Comment Vinci et Bouygues s’approvisionnent-elles en granulats pour la construction des infrastructures de la Coupe du monde 2022 au Qatar ? Aucune de ces entreprises n’a donné suite aux sollicitations de Basta ! sur ces questions. La situation française n’a « rien à voir » avec ces régions du monde où l’on pille du sable directement sur les plages, ou à proximité immédiate de la côte, estime Eric Chaumillon. Mais « il faut rester prudent, le système côtier français étant globalement déficitaire ».
Du recyclage plutôt que le pillage de ressources marines ?
Existe-t-il des alternatives à cette extraction massive de sable ? Selon les professionnels du granulat, l’avenir n’est pas en mer, mais sur les plateformes de recyclage. Chaque année, 100 millions de tonnes de granulats sont récupérées sur les chantiers de déconstruction du BTP. L’essentiel de ces gravats sert aux sous-couches des routes. Mais des recherches sont menées pour tâcher de refaire du béton à partir de ces déchets. Lancé il y a cinq ans, le programme Recybéton a permis de conclure que « les granulats extraits de béton recyclé présentent un vrai intérêt technique, en plus de l’évident intérêt environnemental », indique François Jacquemot, pilote des travaux de recherches sur les bétons à plus faibles impacts environnementaux au Centre d’études et de recherche de l’industrie du béton (Cerib). Problème : l’absence d’intérêt économique. « Les granulats recyclés ne sont pas moins chers que les granulats neufs. Ce n’est pas incitatif. » Une entreprise comme Lafarge, deuxième producteur mondial de granulats et quatrième producteur de béton prêt à l’emploi, ambitionne de fabriquer 20 % de son béton avec des matériaux réutilisés ou recyclés. Mais pour le moment, elle en est à 0,3 %, et reconnaît que le déploiement à grande échelle « reste un challenge » [5].
Grand consommateur de granulats via son activité de BTP et de construction de routes, le secteur public n’est pas particulièrement exemplaire. Les cahiers des charges exigeant un minimum de béton recyclé ou imposant des bâtiments dans lesquels on peut facilement récupérer le béton en fin de vie, n’existent pas ! « Il pourrait aussi y avoir des incitations financières via la taxe sur la partie décharge des chantiers de déconstruction, afin d’encourager à s’orienter vers le recyclage », souligne François Jacquemot. « Il y a un vrai travail de sensibilisation à mener du côté des maîtres d’ouvrage, qui pensent trop souvent que le béton recyclé est de moins bonne qualité », complète Mathieu Hiblot. « Il faudrait aussi revoir certaines normes de conctruction qui freinent voire empêchent l’utilisation de béton recyclé. »
Côté alternatives, il y a aussi les constructions qui se passent de béton. La terre, le bois et la paille sont des matériaux qui ont largement fait leurs preuves et qui présentent des bilans environnementaux bien meilleurs que le béton. Quelques maîtres d’ouvrages publics se sont lancés dans ce type de constructions, mais ils sont encore trop peu nombreux. Pour réduire la pression sur les granulats, il faudrait que les matériaux bio-sourcés cessent d’être ignorés dans les écoles spécialisées – IUT, CFA, écoles d’ingénieurs et d’architecture. On pourrait enfin, comme le suggère l’un des interlocuteurs du documentaire de Denis Delestrac, « oublier notre manie du gigantisme » – qui nous fait construire de plus en plus d’autoroutes, de barrages gigantesques, de tours toujours plus hautes – « pour retourner vers des modes de vie plus simples ».

![]()